Il en est de Shakespeare comme de tous les géants de la littérature: si souvent mis en scène, tant adaptés que leurs textes leur échappent et que le message semble vivre de lui-même. Depuis cinq siècles maintenant, et après avoir éclipsé les dramaturges de son temps, Shakespeare n’échappe pas à ce destin. Sa gloire s’y nourrit aux dépens de l’écrivain et de l’oeuvre. Les personnages haussés au statut de figures emblématiques, des éditions surabondantes 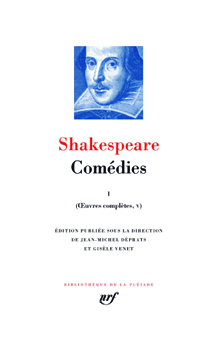 semblent en prouver la modernité mais font oublier que seul le texte est matière pour appréhender ce dramaturge anglais de la fin de la Renaissance, maniériste, baroque mais surtout moderne par l’analyse de son temps.
semblent en prouver la modernité mais font oublier que seul le texte est matière pour appréhender ce dramaturge anglais de la fin de la Renaissance, maniériste, baroque mais surtout moderne par l’analyse de son temps.
La vie même de William Shakespeare semble une mise en scène baroque par une succession de jeux d’illusions. Né en 1564 à Stratford-on-Avon dans le comté de Warwick, sa famille est catholique. Son père, John Shakespere, un paysan devenu peaussier puis échevin et maire incarne l’évolution sociale générée par l’enrichissement du pays. Sa mère, Mary Arden, elle, est issue de la bourgeoisie. L’enfance et les années de formation du dramaturge restent mystérieuses. On sait qu’il se maria en 1582 à dix-huit ans avec Anne Hathaway de huit ans son ainée. Nouvelle disparition de dix ans.
Shakespeare réapparaît en 1592, raillé pour sa malice par le dramaturge Robert Greene. Il a vingt-huit ans, il est dramaturge et acteur reconnu du monde du théâtre élisabéthain. Et cette oeuvre, qui apparaît à la fin de ce siècle de la Renaissance, est aussi fille du règne d’Elisabeth I (1558-1603), dont elle semble porter plus encore l’empreinte, cette souveraine réputée autant pour sa lucidité que pour ses manoeuvres. Sous ce règne d’intrigues et de volonté, les héros de Shakespeare reproduisent tantôt les luttes des factions aristocratiques, tantôt la chute de grandes dynasties. Tragédies et comédies donnent tour à tour à percevoir la façon de supporter ou d’échapper à cette monarchie: distance ou étourdissement.
Toutefois les comédies en témoignent plus encore au rythme effréné des rebondissements et des historiettes plaisantes qui encadrent le thème central de chacune. Des personnages nombreux – de treize à vingt-deux sans compter les figurants – soutiennent une intrigue qui en cache une ou plusieurs autres. Les personnages eux-aussi démultiplient leurs apparences au gré de métamorphoses sociales ou physiques. Dans Les Deux gentilshommes de Vérone Valentin devient le chef d’une bande de hors-la loi, eux-mêmes anciens gentilshommes bannis. Julia se déguise en page afin de rechercher le volage Proteus. Les mondes se mêlent. Dans Le Dressage de la rebelle, Sly, étameur ivrogne, devient lord selon le bon vouloir d’un lord lui-même. Les réels s’imbriquent les uns dans les autres, chaque personnage est susceptible de transformation, les costumes cachent d’autres êtres, d’autres angoisses.
A ce thème baroque du déguisement s’ajoute le merveilleux qui s’immisce dans le réel de la représentation elle-même distante du réel. C’est le jeu de miroirs captivant par les reflets infinis Du Songe d’une nuit d’été . De là le rôle des décors, forêts ombreuses, nuits emplies de sortilèges et de métamorphoses burlesques où Thésée côtoie Obéron, où Titania, la reine des fées, tombe amoureuse d’un âne. C’est le XVI ème mais l’amour est déjà mis en scène dans le jeu du hasard. Les couples se forment, se déchirent, se reconstruisent. Serments, amitié, fidélité sont éprouvés par ces chassés-croisés et le jeu des masques et travestissements assumés ou subis. Du déguisement naît le quiproquo, lui-même source de nouveaux défis.
Mais là ne s’arrête pas l’aspect paradoxalement très élisabéthain des six premières comédies de Shakespeare, il est aussi le miroir de la cour: une cour gaie, fastueuse sans formalisme excessif, préoccupée de culture comme la souveraine elle-même. Et la liberté du genre comique autorise la fantaisie, l’excès, » le grotesque autant que le sublime », dans une effervescence et un enthousiasme qui rappelle autant la truculence des géants rabelaisiens que la belle humeur de l’abbaye de Thélème.
Toutefois les références à l’antique sont passées au crible d’une société plus septentrionale. Le théâtre de Shakespeare fonctionne aussi comme un miroir de l’essor de Londres. Londres est alors la capitale qui incarne l’enrichissement, le luxe, un appétit de jouissance et de divertissement. Elle est la ville par excellence d’un théâtre qui véhicule les idées et les aspirations du siècle, le lieu où s’opposent petites gens et nobles comme dans Le Marchand de Venise. C’est cette effervescence qu’apportent les comédies de Shakespeare qui mèlent intrige(s) sentimentale(s) et mise en sène de la ville. Considérée alors comme « quatrième Etat », Londres développe, en même temps que les prémisses d’un messianisme anglais, une fonction culturelle.
Et le dramaturge et acteur du Globe Theater , protégé de Lord Chamberlain, censeur officiel des représentations théâtrales, donne des représentations où l’harmonie triomphe finalement du désordre et de l’injustice. Les comédies de cette époque vont dans ce sens. Catharina de mégère devient sage, l’inconstant Protéus retrouve Julia, et Silvia Valentin. Démétrius renonce à Hermia pour Héléna, et la première retrouve Lysandre. Mais, avant de parvenir à cet équilibre et retrouver aussi l’équilibre du jour, ce sont rebondissements, joutes farcesques et verbales qui évoquent d’autres modus vivendi, d’autres possibilités d’action, un monde de désordres imités de Plaute ou de la Commedia dell’arte, voire d’ Ovide, mais retravaillés.
Jean Jacquart et Bartolomé Bennassar ont émis la thèse selon laquelle « en Angleterre la Renaissance fut essentiellement littéraire », et que l’oeuvre de Shakespeare en est l’expression majeure, si ce n’est la seule. Les premières comédies, tome V des oeuvres complètes rééditées dans la collection de La Pléiade, révèlent des factures bouillonnantes, des machineries scéniques au service d’un jeu verbal serré. Mais ce travail du dramaturge sur le mot, ses sens et son, sa musique, se double d’une distante ironique par laquelle il se démarque déjà des clichés pétrarquisants et des lieux communs culturels de son siècle. Le burlesque construit sur l’accumulation de figures de styles, de glissements de sens, d’allitérations pléthoriques se moque en réalité des excès rhétoriques et déclamatoires, et laisse entrevoir chez Shakespeare non seulement l’analyse d’un auteur sur la « machinerie verbale », mais aussi une conscience tragique de la destinée humaine. L’édition bilingue accompagnée d’un ample apparat critique et scrupuleusement élaborée sous la direction Jean-Michel Desprats et Gisèle Venet permet de saisir la richesse de ces textes et d’en décrypter à l’envi les codes.
Ces six premières comédies de Shakespeare conçues de 1590 à 1597 dépassent en quelque sorte le maniérisme puisqu’elles ne recherchent pas un effet au détriment du naturel. Par delà les ressorts dramatiques de la surprise, elles révèlent grâce à une extrême recherche un naturel caché, dérobé par les conventions ou les règles de la société élisabéthaine. Dominique Grimardia.
Forks magazine © Forks 2013
William Shakespeare, Comédies.I – Oeuvres complètes, t.VI, Collection La Pléiade, Editions Gallimard.
